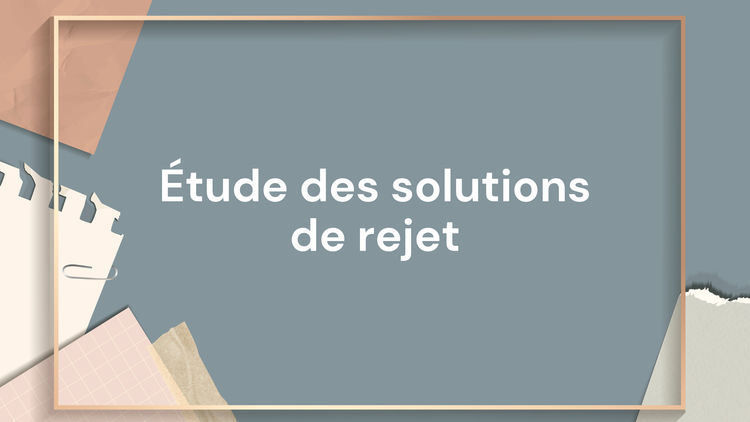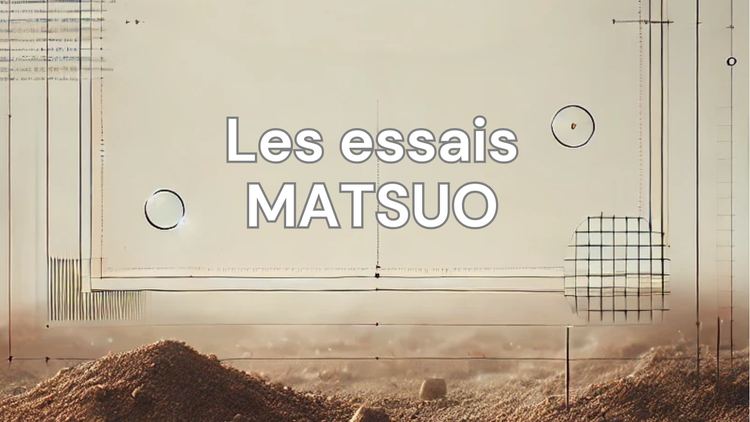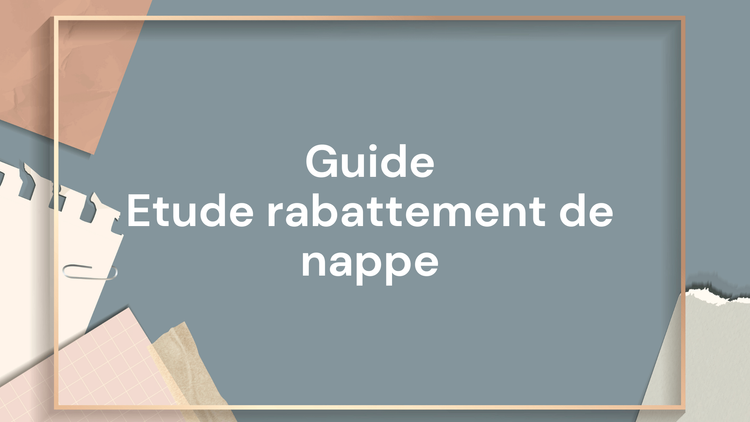L'enquête de quartier
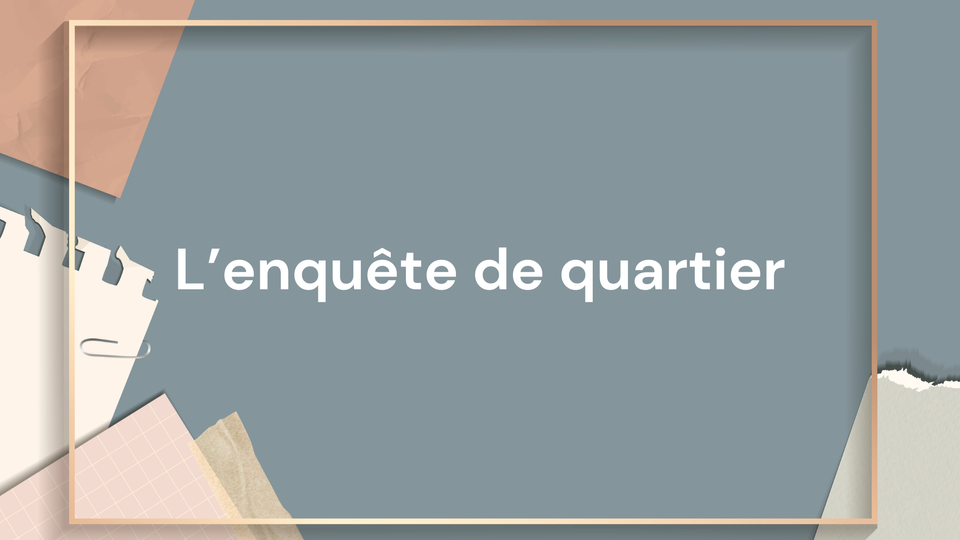
L'hydrogéologie, comme la géologie, est une discipline basée avant tout sur une observation attentive du terrain.
L’enquête de quartier en est une étape incontournable : elle permet de recueillir des informations précieuses sur les événements passés. Indispensable, notamment dans le génie civil pour évaluer les niveaux des plus hautes eaux souterraines (NPHE), elle aide à affiner les hypothèses et à mieux comprendre le comportement des nappes. Un exercice parfois fastidieux, mais incontournable pour toute étude sérieuse.
Dans cet article, nous allons voir comment mener efficacement une enquête de quartier et quelle méthode suivre pour obtenir des informations fiables et utiles.
Etape 1 - Bureau : Préparer le terrain en amont
Une enquête de quartier réussie est avant tout la résultante d'une préparation rigoureuse. Une fois sur le terrain, l’improvisation n’a plus (trop) sa place. Il faudra en amont avoir défini une méthode claire et réfléchi aux bonnes questions en lien avec la problématique du projet, ce qui permettra de collecter des informations précises et essentielles.
Avant de partir sur le terrain, il faut avant tout bien maîtriser votre projet :
- Quelle est la nature du projet ? (construction, aménagement, diagnostic hydrogéologique, sécurisation d’ouvrages existants, etc.)
- Combien y a-t-il de niveaux de sous-sol ? (présence de caves, parkings enterrés, fondations profondes, etc.)
- Quel est le contexte géologique et hydrogéologique de mon site ?
- Quel est le comportement de la nappe ? (variation saisonnière, présence de niveaux perchés, connexion avec des formations plus profondes, y a-t-il un risque de remontée en période de hautes eaux ?)
- Y a-t-il des cours d’eau à proximité ?
- Présence de rivières, ruisseaux, étangs ou plans d’eau susceptibles d’influencer la nappe ?
- Existence de réseaux hydrauliques souterrains (sources, anciens canaux, drainage agricole) ?
- Quel est l’impact potentiel des activités humaines actuelles ?
- Présence de chantiers en cours (rabattement de nappe, terrassements) ?
- Urbanisation récente ou projets d’aménagement à venir qui pourraient modifier l’hydrogéologie locale ?
- Usage des sols (zones industrielles, zones résidentielles, anciens sites d’extraction, remblais) ?
Puis comprendre quels sont les enjeux spécifiques à évaluer ?
- Faut-il des relevés de terrain précis (altimétrie, profondeur de la nappe, nature du sol, remontée de nappe dans les sous-sols, ...) ?
- Faut-il prendre contact avec des acteurs locaux (captages AEP, mairie, associations locales, ...) ?
- Y a-t-il des données préexistantes (cartes géologiques, études antérieures, mesures piézométriques) qu’il faut compléter ou vérifier ?
Le cadre de l'enquête de quartier varie considérablement en fonction du lieu où elle est menée. En milieu urbain, l'objectif principal sera souvent de confirmer des hypothèses en échangeant avec le voisinage et en étudiant l'existant. En revanche, en milieu rural, le manque de données accessibles impose un travail préparatoire approfondi, notamment via des recherches documentaires et des contacts avec les institutions locales ou les habitants.
De même, une enquête de quartier réalisée dans le cadre d'une étude globale d'un bassin versant ne sera pas abordée de la même manière que pour une
Dans une étude de bassin versant, l’objectif sera de comprendre les dynamiques hydrogéologique et leurs interactions avec le milieu naturel et anthropique. L’enquête visera à recueillir des données sur les événements passés (crues, sécheresses) et l’impact des aménagements existants sur les écoulements.
En revanche, pour une enquête liée à un projet de construction ou d’aménagement, l’approche sera plus ciblée : profondeur et variations de la nappe, risques d’infiltration, effets des pompages environnants, ou encore interactions avec les réseaux d’assainissement et de drainage.
Etape 2 - Terrain : interroger, observer, mesurer
Une fois bien préparé, le travail sur le terrain peut commencer. Il repose sur une approche structurée, adaptée à chaque contexte, mais également un bon matériel à l'arrière de la voiture.
Le matériel à avoir dans son sac à dos ou dans sa voiture
🔲 Bloc-notes, stylo, tablette ou dictaphone (pour faire comme dans les films policiers).
🔲 Carte de la zone (placer la carte géologique en fond éventuellement pour éviter de visiter des zones qui ne correspondent en rien au contexte hydrogéologique que vous étudiez).
🔲 Télémètre laser (idéal pour mesurer hauteurs et distances).
🔲 Petite sonde piézométrique dans le sac ou a minima une sonde piézo classique dans le coffre de sa voiture.
🔲 EPI (casque, gilet, chaussures de sécurité) pour rentrer sur les chantiers (soyez paré à tout).
🔲 Ouvre-plaque et outils (tournevis, clé piézo) pour accéder à certains ouvrages (piézomètres, regards).
C'est l'heure de l'enquête
L'enquête de quartier va reposer sur deux axes : les observations directes et les entretiens avec les riverains et professionnels.
Pour le second, préparez-vous à essuyer des portes closes, des regards sceptiques et des réponses évasives. Comme un marchand de tapis en terrain hostile ou une association en quête de dons un dimanche matin, il faudra de la patience, de la persévérance… et votre plus beau sourire !
Observez le terrain...
En premier lieu, ou second, c'est interchangeable, vous allez devoir observer, noter, mesurer et photographier. Notre mémoire étant limitée à la durée d'une vidéo TikTok, ne comptez pas sur elle pour vous rappeler les infos le lendemain lorsque vous essayerez de les traiter.
D'ailleurs, ces infos tant recherchées, quelles sont-elles ? Elles sont nombreuses, diverses et variées, et vont dépendre de l'objectif que vous vous êtes fixé. Voici le top five des infos que vous allez rechercher lors de votre enquête (liste non exhaustive bien évidemment) :
- Sous-sols des bâtiments : relevez le nombre de niveaux, la hauteur des marches, les traces d'infiltration, la présence de cave ou non.
- Protection contre l'eau : identifiez la présence de parois moulées, de tapis drainants, d'évents, de barbacanes, de pompes, ect...
- Indices de présence de nappe ou de nappe haute : observez si le terrain est détrempé, la présence de puits (mesurez le niveau d'eau, pardi !!!), de rigoles de drainage, de traces sur les murs et observez le nom des rues (rue de la Source = pas top top).
- Chantiers en cours : identifiez les dispositifs de pompage, essayez d'obtenir des contacts pour avoir des informations sur les débits de pompage, par exemple.
...et interroger les riverains.
L'art de l'interview est essentiel. Adoptez une approche ouverte et évasive pour ne pas susciter de méfiance (surtout si le projet est sensible auprès des riverains). Ne culpabilisez pas et rappelez vous :
"Tout le monde ment !"
Docteur House
Voici quelques questions qui vous seront utiles :
- "Avez-vous des caves ou des parkings souterrains ? - Est-ce que je peux le visiter ?"
- "Avez-vous ou connaissez-vous des problèmes récurrents liés à l'eau ici ou dans le quartier ?"
- "Avez-vous déjà observé des infiltrations d'eau ?"
- "Lors des derniers évènements de forte pluie, jusqu'à quel niveau l'eau est-elle montée ?"
- "Y a t'il un système de drainage dans votre sous-sol (une pompe ?) ?"
- "Avez-vous un puits ? Y a-t-il des puits dans le secteur ?"
- Sur un chantier voisin :
- Pompez vous la nappe ?
- À quel débit ou quel volume vous pompez par jour ?
- Avez vous prévu de protéger vos sous-sols ? Comment ? Jusqu'à quelle cote ? Pouvez-vous me transmettre l'étude NPHE et débit d'exhaure ?
- Est ce que je peux avoir un contact ?
Et je structure comment ma fiche de suivi ?
Soit un carnet avec la liste de question, soit vous pouvez faire un tableau avec :
💧 Le numéro de l'arrêt.
💧 L'adresse complète.
💧 La présence d'un sous-sol - Le nombre de sous-sol - La profondeur du sous-sol.
💧 Le type de protection du sous-sol.
💧 La présence d'infiltration ? Quelle cote ?
💧 Commentaire
Etape 3 - Bureau : Exploitation des données
De retour au bureau, il est temps de trier et d’organiser les informations collectées afin d’identifier celles qui sont pertinentes pour l’étude. Ce travail de sélection permet d’éliminer les éléments inutiles ou redondants et de structurer les données en vue de leur exploitation technique.
Organisation et structuration des données
Une fois les données collectées sur le terrain, elles doivent être centralisées et organisées de manière méthodique :
- Compiler les observations sur un tableau de synthèse (un tableau Excel) afin de faciliter l’analyse et la comparaison.
- Géoréférencer les points d’intérêt sur une carte SIG afin d’avoir une vision spatialisée des éléments clés de la visite (puits, sources, zones d’infiltration, points de pompage, parking, type de protection).
Dans le rapport final, afin d'éviter que ce soit le bazar sur la carte, vous pouvez juste mettre le numéro de référence de l'arrêt. - Convertir, si nécessaire, les altitudes relevées en mètres NGF pour assurer la cohérence des données avec les référentiels de l'étude.
- Si nécessaire, il peut être utile de recontacter certains interlocuteurs pour clarifier certains points ou obtenir des compléments d’information.
Vérification et recoupement des informations
La dépouille des données étant désormais réalisée, il est temps de passer à l’un des aspects les plus importants de l’exploitation des données : le recoupement des informations. C'est le moment de comparer les observations de terrain avec nos hypothèses de calcul afin d’en vérifier la fiabilité et la cohérence et, le cas échéant, de s'interroger sur les raisons de ces écarts.
Voyons quelques exemples :
- Présence d’eau dans des caves ou sous-sols : une infiltration signalée peut être corrélée à un niveau élevé de la nappe. Il convient alors de vérifier si la hauteur d’eau mesurée correspond aux valeurs connues dans la zone, ou s'il s'agit d'une fuite de réseau ou autre.
- Relevés dans des puits ou forages : les mesures effectuées dans des ouvrages existants lors de l'enquête de quartier permettent d’affiner et d'étendre la carte piézométrique locale et de mieux comprendre le comportement de la nappe.
- Indices liés à l’aménagement des bâtiments :
- Si plusieurs bâtiments sont équipés d’évents, présentent une cote de protection uniforme ou disposent d’un tapis drainant, cela peut indiquer une contrainte hydrogéologique particulière (nappe sub-affleurante, risque d’inondation, etc.).
- Une absence de tels aménagements peut suggérer une situation hydrogéologique plus stable. Peut-être êtes-vous en train de surévaluer la hauteur de nappe.
- Impact des chantiers en cours :
- En cas de pompage de nappe sur un chantier voisin, il faut se renseigner sur le débit de pompage et essayer d'évaluer le rabattement qu'il induit sur votre projet. Un rabattement significatif peut fausser les mesures dans les piézomètres de votre projet, ce qui aura d'importantes conséquences sur vos dimensionnements.
Vous êtes prêts, à vous de jouer !
Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour mener une enquête de quartier efficace ! Pour résumer : frappez aux portes, scrutez les parkings, posez des questions, insistez, et surtout, fouinez.
Observez chaque détail, entrez sur les chantiers pour mesurer, identifiez les cotes de cuvelage des parkings et repérez les éventuels dispositifs de rabattement de nappe. Plus vous récoltez d’infos, plus votre analyse sera solide.
Alors, chaussez vos bottes, armez-vous de votre carnet de notes et de votre meilleure persuasion… et plongez dans le terrain !