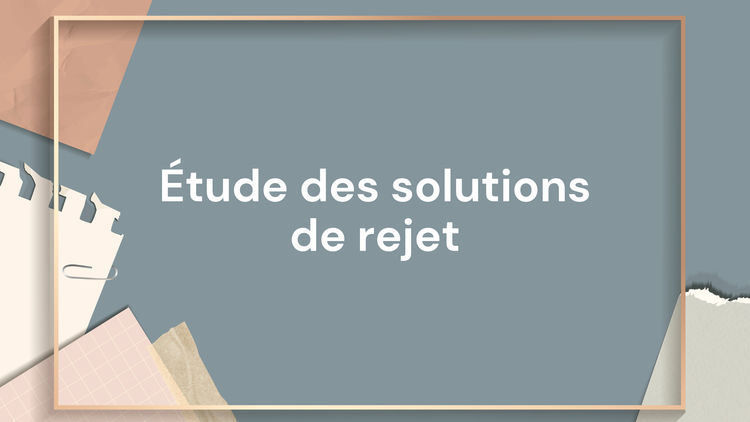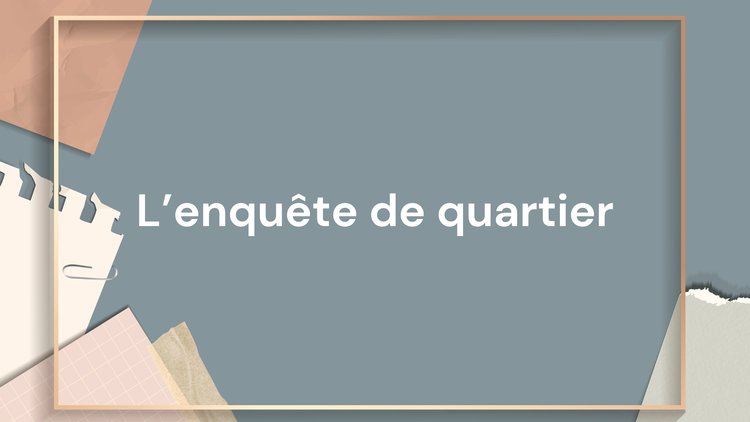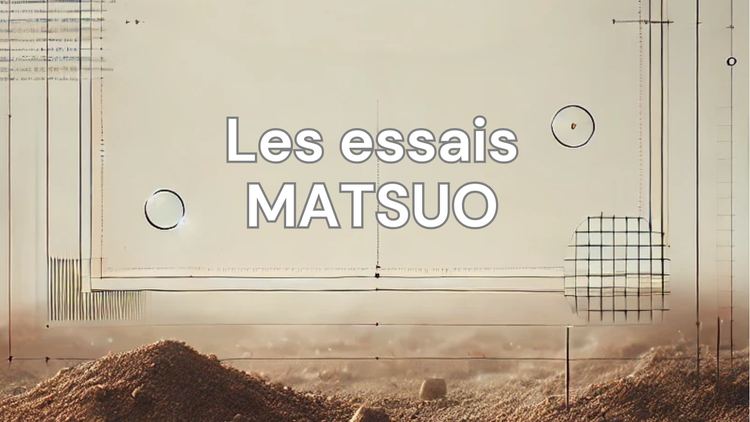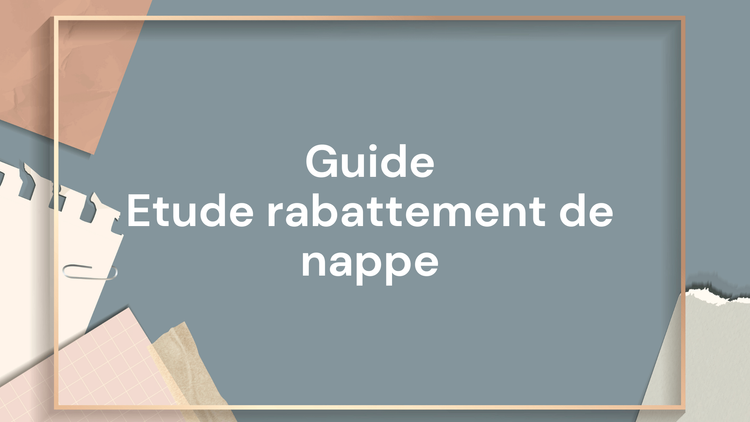Introduction aux Essais en Hydrogéologie : Comprendre et Caractériser les Aquifères
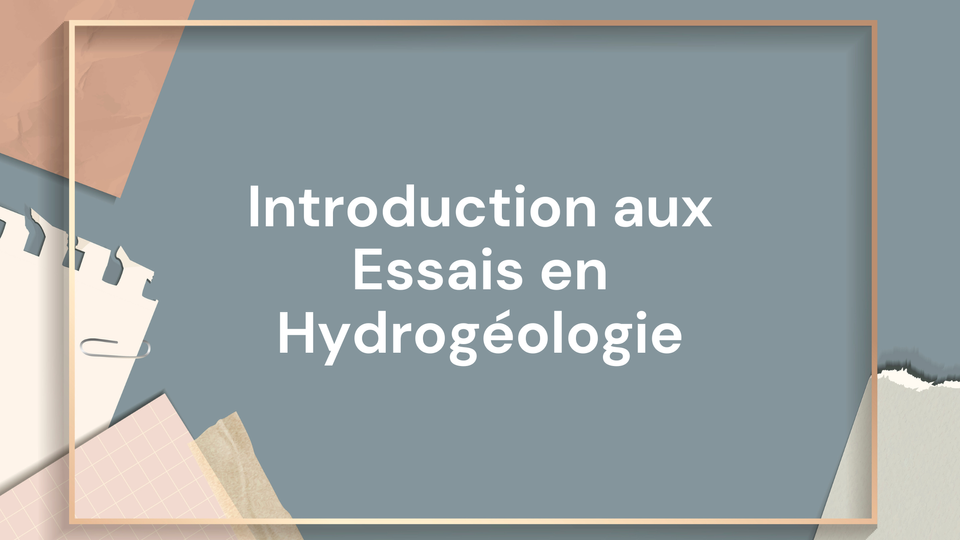
Pour de nombreuses opérations du génie civil, comprendre les sols et la dynamique des nappes est indispensable pour concevoir des infrastructures durables, prévenir les désordres liés à l’eau souterraine ou encore opter pour une solution énergétique bas carbone comme la géothermie.
Les essais en hydrogéologie, c'est l'équivalent d'un diagnostic médical : ils permettent d’examiner la structure du sous-sol, de caractériser les écoulements souterrains et de comprendre le comportement précis, à l'échelle de votre projet, des terrains et des nappes souterraines.
Découvrons ensemble ces investigations indispensables pour une ingénierie maîtrisée du sous-sol.
Essais d'eau : évaluation des propriétés hydrodynamiques et compréhension du fonctionnement des aquifères
Ces essais sont utilisés pour analyser le comportement des aquifères et comprendre leur fonctionnement. Ils permettent de mesurer des paramètres clés comme la perméabilité, la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement. Ces données sont essentielles pour dimensionner les ouvrages d’exploitation, adapter les conditions de pompage et anticiper les fluctuations du niveau des nappes.
Essai de vidange (ou Lefranc)
L’essai de vidange aussi appelé essai Lefranc est utilisé pour mesurer la perméabilité des formations peu perméables.
Il consiste à pomper l’eau d’un piézomètre jusqu’à sa vidange complète, puis à observer la remontée du niveau d’eau à intervalles réguliers. Les variations enregistrées permettent de calculer la perméabilité des terrains.
Pour que ces essais soient représentatifs, il faut multiplier ces essais à différents emplacements du site. Une seule mesure peut être trompeuse en raison des hétérogénéités naturelles du sol.
Essai de nappe (ou essai de pompage longue durée)
L’essai de nappe permet de déterminer la transmissivité et le coefficient d’emmagasinement d’un aquifère afin d’évaluer sa capacité à transmettre et stocker l'eau.
Il implique de pomper de l'eau dans un puits à débit constant tout en mesurant la baisse du niveau d’eau dans plusieurs forages d'observation situés à différentes distances.
La durée de l’essai dépend des caractéristiques de l’aquifère et des objectifs de l’étude, pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours. Les variations du niveau sont enregistrées à intervalles réguliers pour tracer les courbes de rabattement et de relèvement, permettant ainsi le calcul des paramètres hydrodynamiques.
Essai de puits (ou essai par palier)
L’essai de puits permet d’évaluer la productivité d’un puits et d’optimiser son exploitation en évitant un rabattement excessif.
Il consiste à pomper de l’eau en augmentant le débit par paliers tout en mesurant la baisse du niveau piézométrique à l’aide d’une sonde. Les données recueillies permettent d’analyser la performance du forage et d’adapter les conditions d’exploitation pour assurer un débit durable.
Essai d'injection
L’essai d’injection teste la capacité d’un aquifère à absorber une recharge ou un rejet d’eau. Ce type d'essai est très utilisé en géothermie par exemple.
L’eau est injectée sous pression dans un puits, et la dissipation de la pression ainsi que l’évolution du niveau piézométrique sont surveillées pour déterminer la perméabilité et la capacité d’infiltration du réservoir.
Essai micromoulinet
L’essai au micromoulinet est utilisé pour mesurer la vitesse et la direction et la position des écoulements d’eau souterraine à l’intérieur d’un puits, notamment pour identifier les zones de circulations préférentielles. Cela sera très utile par exemple pour identifier les zones de fractures d’un aquifère.
Il est réalisé grâce à l’immersion d’un micromoulinet équipé d’une hélice calibrée à différentes profondeurs et à enregistrer les variations de vitesse. Ces données permettent d’analyser les flux souterrains et d’identifier la position des arrivées d'eau.
Essais d'infiltration : estimation de la capacité d'infiltration des sols
Ces essais, qui concernent à vrai dire plus le domaine de l'hydrologie que de l'hydrogéologie, sont utilisés pour évaluer la capacité des sols à absorber et transmettre l’eau. Ils permettent de mesurer la vitesse d’infiltration et la perméabilité du sol, des paramètres essentiels pour la gestion des eaux pluviales et la conception d’ouvrages d’infiltration.
Essai Matsuo
L’essai matsuo est utilisé pour mesurer la capacité d’infiltration des sols superficiels, notamment dans les études de gestion des eaux pluviales.
Sa mise en œuvre repose sur le creusement d’une fosse peu profonde, à y verser de l’eau et à observer son infiltration. La baisse du niveau est enregistrée à intervalles réguliers afin de calculer la perméabilité du sol et d’analyser sa capacité à absorber l’eau en conditions naturelles.
Essai Porchet
L’essai porchet est utilisé pour mesurer la perméabilité d’un sol saturé, notamment pour la gestion des eaux pluviales.
Cet essai implique de creuser un trou (à la tarière par exemple), à le remplir d’eau et à observer son infiltration via un outil appelé infiltromètre. Après une phase de saturation, l’eau est maintenue à un niveau constant, et la quantité ajoutée est mesurée pour calculer la vitesse d’infiltration et analyser la capacité du sol à absorber et transmettre l’eau.
Essai à double anneau
L’essai à double anneau est utilisé pour mesurer l’infiltration verticale en limitant l’effet de drainage latéral.
Il repose sur deux anneaux concentriques enfoncés dans le sol et remplis d’eau. L’anneau extérieur crée une zone saturée, forçant l’infiltration dans l’anneau intérieur. La baisse du niveau d’eau dans cet anneau est mesurée à intervalles réguliers pour calculer la perméabilité du sol et sa conductivité hydraulique.
Traçages hydrogéologiques : suivre les circulations d’eau
Les traçages sont utilisés pour analyser les écoulements souterrains et identifier les connexions hydrauliques entre différents réservoirs. Ils permettent de suivre le trajet de l’eau, d’évaluer la vitesse de circulation et de comprendre les interactions entre les réservoirs. Ces données sont essentielles pour la gestion des ressources en eau et la protection des captages.
Traçage colorimétrique
Le traçage colorimétrique est utilisé pour visualiser les écoulements souterrains et identifier les connexions entre différentes zones d’un aquifère.
Un colorant, comme la fluorescéine ou la rhodamine, est injecté dans un point d’eau et suivi en aval grâce à des prélèvements ou des capteurs. L’analyse de son déplacement permet d’interpréter la vitesse et les directions d’écoulement de l’eau souterraine.
Traçage avec sel ou isotope
Le traçage avec sel ou isotope suit pour objectif de suivre les écoulements souterrains et estimer la vitesse de déplacement de l’eau.
Pour ce faire, un traceur chimique ou isotopique est injecté dans un point d’eau et à surveiller son apparition en aval. L’analyse des concentrations permet de modéliser le temps de transfert de l’eau et d’identifier les connexions hydrauliques entre les réservoirs.
Traçage biologique
Le traçage biologique est utilisé pour suivre les écoulements souterrains en milieu karstique et identifier les connexions hydrauliques.
Des spores ou bactéries sont injectés dans un point d’eau et à surveiller leur réapparition en aval. L’analyse de leur déplacement permet de caractériser les chemins préférentiels d’écoulement et d’évaluer la vitesse de circulation de l’eau.
Investigations complémentaires
Ces investigations sont utilisées pour compléter les analyses hydrogéologiques en fournissant des données sur la structure du sous-sol et l’état des forages. Elles permettent d’identifier d’éventuelles anomalies, d’optimiser l’implantation des ouvrages et de diagnostiquer les dysfonctionnements pouvant affecter les aquifères.
Inspection par caméra de forage
L’inspection caméra permet d’évaluer l’état interne d’un forage en identifiant les fissures, colmatages et défauts structurels.
Une caméra est descendue dans le puits pour examiner les parois et détecter d’éventuelles anomalies. L’analyse des images permet de diagnostiquer l’altération du forage et d’orienter les interventions de maintenance ou de réhabilitation.
La Géophysique
La géophysique permet d’explorer la structure du sous-sol sans réaliser de forage (une échographie du sous-sol), notamment pour repérer les aquifères, localiser les nappes et détecter d’éventuelles intrusions salines.
Il repose sur des techniques comme la résistivité électrique, la sismique et l’induction électromagnétique, qui permettent de cartographier les variations du sous-sol et d’orienter les études hydrogéologiques.
Et voilà, vous avez maintenant une vision globale des essais et investigations couramment utilisés en hydrogéologie.
Ces méthodes permettent de mieux comprendre les aquifères, d’optimiser la gestion des ressources en eau et d’anticiper les impacts d’une exploitation. Chaque essai répond à des besoins spécifiques et doit être sélectionné en fonction des objectifs du projet. des objectifs du projet et des caractéristiques du milieu naturel.
Et pour cela, rien de mieux que de ce faire conseiller par un spécialiste. Pour cela, consultez notre annuaire !